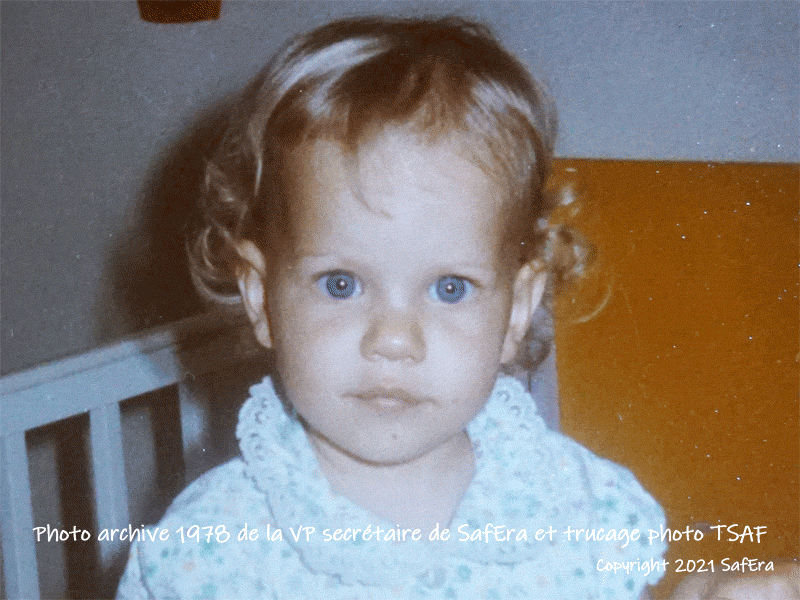 |
Le saviez-vous ?Moins de 10% des personnes atteintes ont les trois traits faciaux caractéristiques du TSAF (10).Mais, 94 % des personnes atteintes de TSAF ont un trouble de santé mentale concomitant (7) |
Le Trouble du Spectre de l'Alcoolisation Fœtale (TSAF) est un ensemble de troubles qui peuvent se développer chez les personnes ayant subit une exposition prénatale à l'alcool. Il peut avoir des répercussions graves sur la santé du fœtus, engendrant des anomalies physiques, cognitives et comportementales.
Anomalies Physiques: Le TSAF peut provoquer des anomalies physiques chez le fœtus, telles que des malformations faciales, des défauts cardiaques, des troubles de croissance, et des problèmes au niveau des organes.
Anomalies Cognitives: Les enfants atteints du TSAF peuvent présenter des problèmes cognitifs, notamment des retards dans le développement du cerveau, des difficultés d'apprentissage, et des troubles du comportement.
Anomalies Comportementales: Les personnes affectées par le TSAF peuvent éprouver des problèmes de comportement, y compris des troubles de l'attention, des difficultés à gérer leurs émotions, et des défis dans les interactions sociales.
Il est essentiel de noter que aucune limite minimale de consommation d’alcool n’est reconnue sécuritaire pendant la grossesse. La prévention et la sensibilisation à ce trouble revêtent une grande importance pour protéger la santé de la population.
L’alcool sous toutes ses formes est tératogène (1,2) c'est à dire qu'il peut provoquer des malformations.
1. Lévesque S, April N. Alcool. Portrait d’information périnatale [En ligne]. Québec : Institut national de santé publique du Québec; 2019. https://www.inspq.qc.ca/information-perinatale/-fiches/alcool
2. Cook JL. Consommation d’alcool pendant la grossesse et trouble du spectre de l’alcoolisation foetale au Canada: qui, quoi, où? Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada Recherche, politiques et pratiques. 2021;41(9):292‑4. https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.9.03f
3. Legault LM, Bertrand-Lehouillier V, McGraw S. Pre-implantation alcohol exposure and developmental programming of FASD: an epigenetic perspective. Biochem Cell Biol. 2018;96(2):117‑30. https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/bcb-2017-0141
4. Jonsson E, Salmon A, Warren KR. The international charter on prevention of fetal alcohol spectrum disorder. The Lancet Global Health.2014;2(3):e135‑7. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(13)70173-6/fulltext
5. Long X, Lebel C. Evaluation of Brain Alterations and Behavior in Children With Low Levels of Prenatal Alcohol Exposure. JAMA Network Open.2022;5(4):e225972. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.5972
6. Legault LM, Doiron K, Breton-Larrivée M, Langford-Avelar A, Lemieux A, Caron M, et al. Pre-implantation alcohol exposure induces lasting sex-specific DNA methylation programming errors in the developing forebrain. Clin Epigenetics. 2021;13(1):164. https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-021-01151-0
7. Anderson, T., Mela, M., & Stewart, M. (2017). The implementation of the 2012 mental health strategy for Canada through the lens of FASD. Canadian Journal of Community Mental Health, 36(4), 69–81.
8. Bernes G, O’Brien J, Mattson SN. Profils neurocomportementaux spécifiques à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Dans: Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Éd. rév. [En ligne]. États-Unis; 2020. http://www.enfant-encyclopedie.com/-sites/default/- files/textes-experts/fr/37/profils-neurocomportementaux-specifiques-alensemble-des-troubles-causes-par-lalcoolisation-foetale.pdf
9. Cook JL, Green CR, Lilley CM, Anderson SM, Baldwin ME, Chudley AE, et al. Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan. CMAJ. 2015;188(3):191‑7. http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.141593
10. Réseau de recherche Canada FASD. Trouble du spectre de l’alcoolisation foetale. 2021;2. https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/CanFASD_WhatIsFASD_Brochure_FR.pdf
11. Popova S, World Health Organization, Centre for Addiction and Mental Health. Étude internationale de l’Organisation mondiale de la Santé sur la prévalence du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF): volet canadien. Institut de recherche sur les politiques en matière de santé mentale, Centre de toxicomanie et de santé mentale. 2018. https://www.-camh.ca/-/media/files/pdfs---reports-and-books---research/who-fasd-report-french-april2018-pdf.pdf
12. Popova S, Lange S, Shield K, Mihic A, Chudley AE, Mukherjee RAS, et al. Comorbidity of fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. 2016;387(10022):978‑87. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673615013458
13. Durr MRR, Petryk S, Mela M, DesRoches A, Wekerle M, Newaz S. Utilization of psychotropic medications in children with FASD: a retrospective review. BMC Pediatrics. 2021;21(1):512. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02986-5
14. McLachlan K, Flannigan K, Temple V, Unsworth K, Cook JL. Difficulties in Daily Living Experienced by Adolescents, Transition-Aged Youth, and Adults With Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2020;44(8):1609‑24. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.14385
15. Nadeau D, Bussières ÈL, Servot S, Simard MC, Muckle G, Paradis F. L’exposition prénatale à l’alcool et aux drogues chez des bébés signalés en protection de l’enfance à la naissance: la pointe de l’iceberg? École de service social de l’Université Laval; 2020;66(1):99‑113. https://www.erudit.org/fr/revues/ss/2013-v59-n2-ss05253/1068923ar/
16. Flannigan K, Kapasi A, Pei J, Murdoch I, Andrew G, Rasmussen C. Characterizing adverse childhood experiences among children and adolescents with prenatal alcohol exposure and Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Child Abuse Negl. 2021;112:104888. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420305433
17. Popova S, Lange S, Bekmuradov D, Mihic A, Rehm J. Fetal Alcohol Spectrum Disorder Prevalence Estimates in Correctional Systems: A Systematic Literature Review. Can J Public Health.2011;102(5):336‑40. https://doi.org/10.1007/BF03404172
18. Graves L, Carson G, Poole N, Patel T, Bigalky J, Green CR, et al. Guideline No. 405: Screening and Counselling for Alcohol Consumption During Pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. Elsevier; 2020;42(9):1158-1173.e1. https://www.jogc.com/article/S1701-2163(20)30223-1/fulltext
19. Walker MJ, Al-Sahab B, Islam F, Tamim H. The epidemiology of alcohol utilization during pregnancy: an analysis of the Canadian Maternity Experiences Survey (MES). BMC Pregnancy and Childbirth. 2011;11(1):52. https://doi.org/10.1186/1471-2393-11-52
20. Joubert K, Baraldi R, Institut de la statistique du Québec. La santé des Québécois: 25 indicateurs pour en suivre l’évolution de 2007 à 2014: résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Institut de la statistique du Québec. 2016. http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2742960
21. Cheng D, Kettinger L, Uduhiri K, Hurt L. Alcohol consumption during pregnancy: prevalence and provider assessment. Obstet Gynecol. févr 2011;117(2):212‑7. https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2011/02000/Alcohol_Consumption_During_Pregnancy__Prevalence.3.aspx
SafEra tient à remercier chaleureusement, pour sa collaboration et l'aide à la mise à jour des informations ici exposées, l'auteure de l’outil d’interventions 2022 : France Paradis, M.D., M.Sc, Médecin responsable du dossier Grossesse et alcool, DSPu de la Capitale-Nationale et Chercheure clinicienne au CRUJeF. Ainsi que ces collaborateur.trice.s : Association pour la santé publique du Québec [ASPQ] : Isabelle Létourneau, B. Com, Chargée du projet TSAF Sylvie Roy, Dt.P., M. Sc. Chargée de projets ; le CIUSSSCN ; GMF : Fabienne Saint-Cyr M.S.S., T.S. et Psychothérapeute ; DSPu : Michel Bernier, M.D. et Nadine Dubois, M.D. ; Louise Paradis, M.A., anthropologue médicale
Comme quoi, ensemble on va plus loin.
SafEra, le seul organisme
|

|
Vivre avec le TSAF : un défi de tous les jours pour toute la familleGuillaume est un jeune adulte atteint du TSAF. Il est fier du chemin qu’il a parcouru malgré les embûches multiples et grâce au soutien de ses proches. Avec son père, Marc-André, ils partagent à coeur ouvert et sans tabous leur quotidien avec ce trouble.Pour en savoir plus, voyez aussi les vidéos de la campagne Pendant la grossesse, on boit sans alcool. Visionner sur Youtube🔗 |

|
Vivre avec le TSAF : en savoir plusPerceptions Podcast #42. Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale avec Annie & GuillaumeDans cet épisode, nous parlons de ce qu'est le TSAF, des problèmes que ça peut amener, des risques reliés à la prise d'alcool durant la grossesse, des difficultés que Guillaume rencontre au quotidien et plus encore. C'est un épisode super enrichissant, je suis certaine que vous allez adorer Guillaume et Annie.Bonne écoute! Visionner sur Youtube 🔗 👇Clique ici |
Dans un souci de partager les meilleures pratiques et de bénéficier des expertises les plus avancées sur la question des TSAF au niveau international, je suis entrée en lien avec l’organisme québécois SafEra dont les productions sont particulièrement utiles pour nous et d’une grande qualité. SafEra anime plusieurs communautés de pratique avec des familles d’accueil ou adoptives et l’idée d’entrer dans un échange approfondi France-Québec paraissait donc logique. La première chose qui m’a frappée est leur approche très concrète et pragmatique des troubles : comment faire, que peut-on faire dans telle ou telle situation ? Une approche à laquelle je souscris car elle rejoint l’idée de sortir de l’impuissance pour accompagner, que la pensée se construit dans l’action et l’action dans la pensée. Penser pour ne pas agir, cela n’aide pas l’enfant quand la question est bien celle de comment faire, car oui il est possible de faire quelque chose quand il s’agit de permettre à l’enfant de développer son plein potentiel, en tenant compte de ses forces et de ses difficultés. Les premiers échanges entre nous ont été riches et fructueux, et nous avons appris énormément en peu de temps grâce à Annie Rivest et Annie McClure. Ce petit texte est un juste retour de ce partage, la réciprocité étant une des clés d’une communauté de pratique : celle de donner et recevoir, et nous espérons que cette collaboration aura une longue vie. Cela montre s’il en était besoin que les démarches collectives sont porteuses de possibles et de changement positif, car oui « ensemble on va plus loin », pour le bénéfice des enfants accueillis et de ceux et celles qui prennent soin d’eux.
- Karima Gacem, animatrice de la communauté de pratique COP TCAF, salariée-doctorante au sein de la fondation Grancher-Université Paris Nanterre.